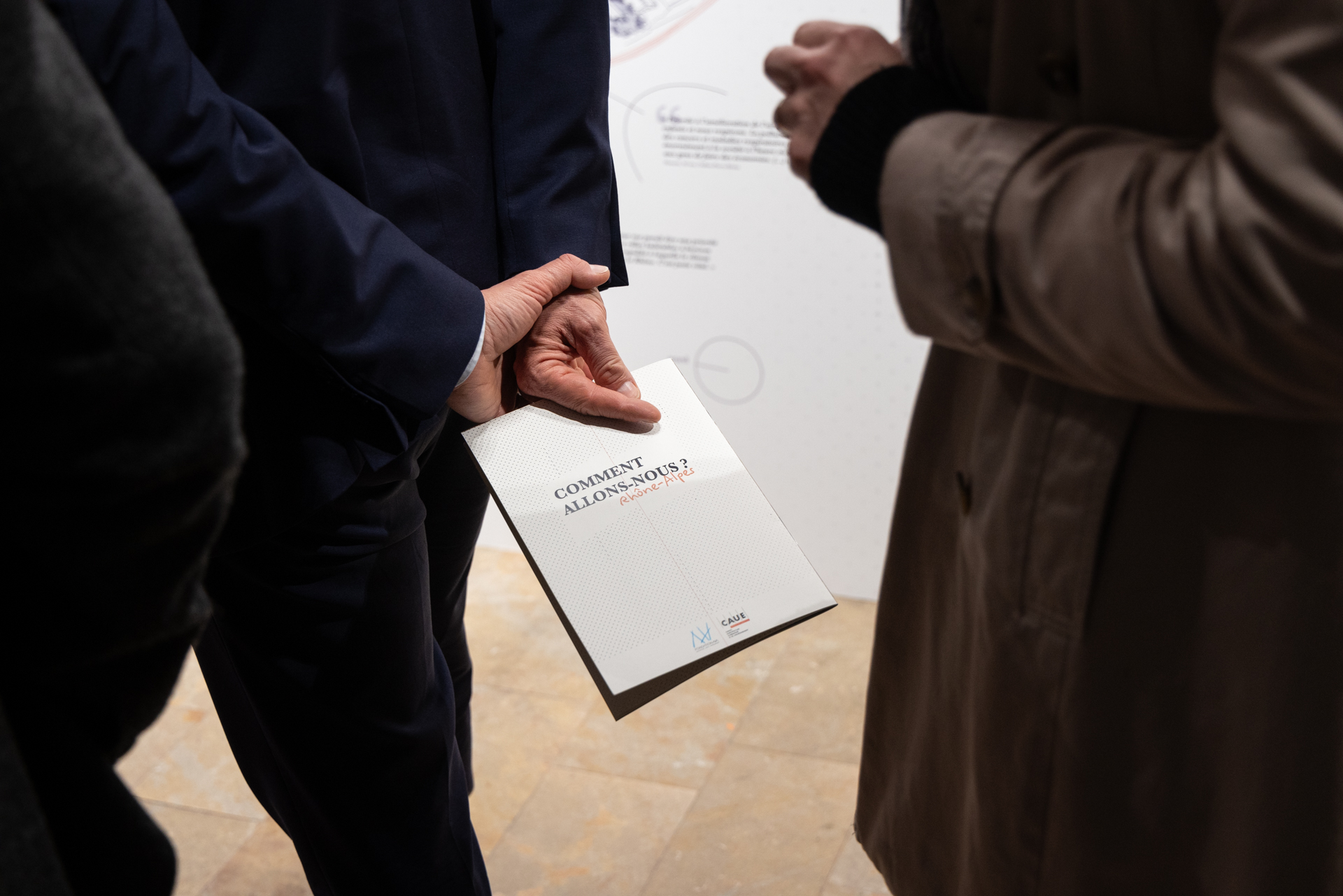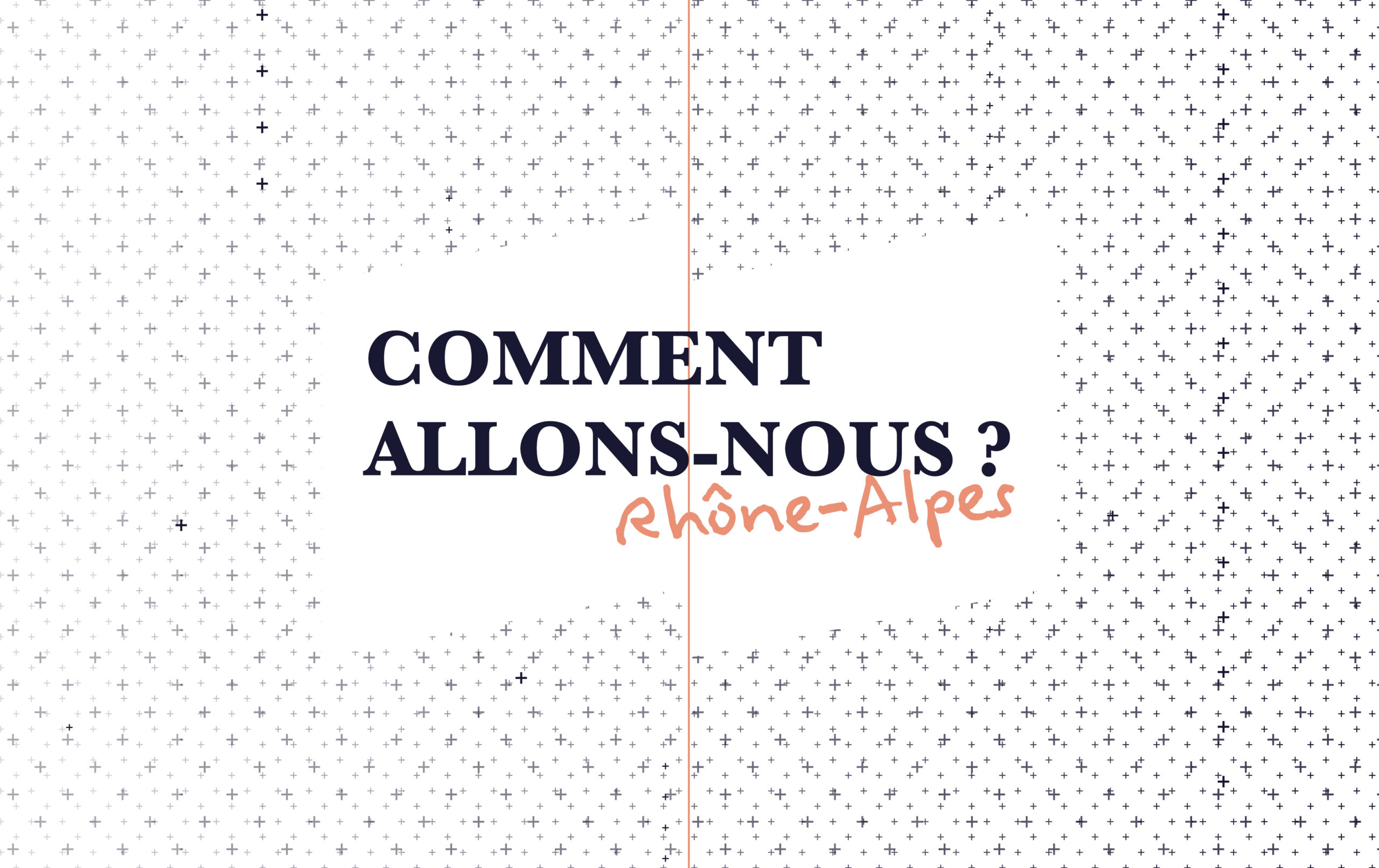Dans un contexte où l’urbanisme doit changer de paradigme pour reconnaître et intégrer les bénéfices immatériels du refuge, de l’art, de la nature, de la santé… explorer les démarches collectives d’artistes, d’urbanistes, d’architectes, peut nous aider à transformer les interstices urbains et les espaces publics en véritables lieux d’hospitalité, favorisant la santé, le bien-être et le lien social des citadins.
La Fondation AIA mène depuis plusieurs années un travail de recherche sur le lien entre ville, santé et vulnérabilité. Dans la continuité de ses publications (Bien vivre la ville, 2016 ; Bien vivre la ville, vers un urbanisme favorable à la santé, 2018), elle explore aujourd’hui l’axe de l’(in)hospitalité en ville, en s’interrogeant sur les formes contemporaines d’accueil, de refuge et de soin dans un contexte urbain marqué par la précarité, les
vulnérabilités sociales et la crise écologique.
La notion d’hospitalité est envisagée dans un sens élargi : accueil des personnes mais aussi soin apporté aux lieux, aux corps, aux écosystèmes, aux pratiques quotidiennes. Les travaux en cours de la Fondation mettent en évidence le rôle des espaces publics et interstitiels comme leviers de santé et de lien social et la nécessité d’une approche transdisciplinaire intégrant architectes, urbanistes, artistes, sociologues, médecins, citoyens. Dépasser les logiques purement financières est essentiel pour redonner leur juste place dans le projet aux bénéfices immatériels (bien-être, inclusion, justice spatiale, biodiversité).
© Photo à la une : Noémie Lacote.